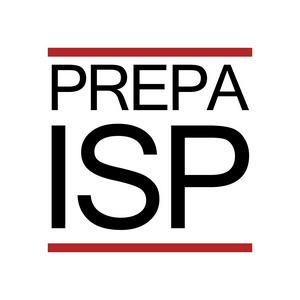L'inéligibilité (de Marine Le Pen)
La judiciarisation de la vie politique n’est pas nouvelle, mais le sentiment général est qu’elle ne cesse de s’accroitre. La faute à quoi ? à qui ? aux magistrats ou aux politiques ?
Le peuple veut de la transparence et de l’intégrité, la HATVP, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique remplit des fonctions préventives et institutionnelles. Mais cela ne suffit guère à s’assurer d’une vie politique vertueuse.
Et lorsque les faits reprochés aux personnes politiques relèvent de sa compétence, le juge intervient naturellement, mais alors la décision judiciaire prend une importance, un relief et a un écho sociétal et médiatique parfois considérable, allant bien au-delà de l’autorité traditionnelle de la chose jugée, si vous me permettez ce trait ironique, cet abus de langage du juriste que je suis.
Ne serait-ce que dans les temps récents, on se rappelle des affaires Balkany, Cahuzac, Chirac, Fillon, Juppé, Jean-Marie Le Pen, Sarkozy, Thévenoud, Tron. Que tous ceux que j’ai oubliés me pardonnent, ils sont si nombreux…
Parmi eux, certains ont été condamnés pour des faits extérieurs à la vie politique, d’autres à des infractions directement liées à celle-ci, emplois fictifs, détournements de fond.
Parmi eux encore, certains ont été condamnés à des amendes, des peines d’emprisonnement, des peines d’inéligibilité avec ou sans exécution provisoire
Le 31 mars 2025, Bruno Gollnish, Louis Aliot, Nicolas Bay ont été condamnés avec d’autres par le tribunal correctionnel de Paris. Marine Le Pen notamment, condamnée sur le fondement du délit de détournement de fonds publics.
Comme il fallait s'y attendre, la décision rendue par le tribunal suscite une tempête politico-médiatique.
Les uns se réjouissent car ils pensent que Marine Le Pen ne pourra pas se présenter aux élections présidentielles de 2027, les autres se lamentent et présentent Marine Le Pen comme la cible d'un complot politico-judiciaire fomenté par les « juges rouges », une « cabale judiciaire ».
L'une des causes de la situation, même si ce n'est pas la seule, réside sans doute dans un débat juridique qui semble complexe et dont la compréhension exige tout à la fois un éclairage sur l’état du droit et une lecture attentive de la décision du tribunal, soit plus de 150 pages.
Une autre cause évidente tient aux conséquences que cette décision et ses éventuelles suites pourraient avoir sur les élections présidentielles de 2027, madame Le Pen créditée aujourd’hui dans les sondages de plus 30% des suffrages au premier tour ne pourra-t-elle pas se présenter ?
Faut-il revoir le droit pénal et la peine d’inéligibilité ? Faut-il écarter en certaines circonstances le prononcé de l’exécution provisoire ? Faut-il prévoir des procédures d’urgence en la matière ? Les hommes et femmes politiques doivent-ils, en certaines circonstances au moins, être extraits des procédures judiciaires de droit commun ?
Pour répondre à ces questions et faire le point sur une situation finalement inédite je reçois Jean-Paul Gélin, professeur de droit public au sein de la Prépa ISP.